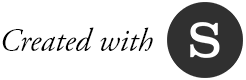C'est au Brésil que l’on épand le plus de pesticides au monde, et le géant bâlois de l’agrochimie Syngenta est le numéro un de ce gigantesque marché. Quel est l’impact de l'utilisation massive de pesticides extrêmement dangereux sur les populations vivant à proximité des champs de soja, de maïs et de coton qui s’étendent à perte de vue? Dans l'État du Mato Grosso, nous nous sommes lancés sur les traces toxiques d’un modèle d’affaires lucratif aux conséquences désastreuses pour la santé et l’environnement. Dans un monde où, par peur de représailles, le silence est la règle.

Des légumes sains, des familles heureuses du monde entier, des agriculteurs et agricultrices déterminés et de magnifiques paysages. Le tout accompagné d’une musique entêtante qui souligne toute l’importance de la présentation. Un homme en costume sombre, yeux bleus perçants, appuie par sa gestuelle ses belles paroles, qu’il veut convaincantes. Dans cette vidéo publiée sur Youtube, Syngenta nous raconte, en une minute et vingt secondes, «le futur de l’agriculture durable».
«The future of sustainable agriculture», Syngenta, 2018
L'homme en question est Erik Fyrwald, le directeur général de Syngenta. Il décrit une agriculture qui non seulement fournit aux consommateurs de «merveilleux aliments, sûrs, abordables et sains», mais qui le fait tout en «protégeant notre planète». Il enchaîne: «Nous, Syngenta, reconnaissons que nous devons écouter les agriculteurs, l'industrie alimentaire, les détaillants, les ONG et les autorités de régulation dans le cadre d'un dialogue ouvert sur ce que signifie réellement l'agriculture durable, et sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour que les bonnes choses arrivent». Il promet: Syngenta écoutera et prendra des «engagements» pour continuer à «rendre le monde meilleur. Pour nos enfants, nos petits-enfants et les innombrables générations à venir.» Roulements de tambour.
Cher Monsieur Fyrwald, nous sommes heureux de savoir que vous nous écoutez, car nous devons vous parler d’un sujet important. Public Eye a enquêté pendant plusieurs mois sur un secteur d’activité central pour votre entreprise, mais qui est difficilement conciliable avec la volonté de «protéger notre planète» ou de «faire en sorte que les bonnes choses arrivent». Il s’agit d’un commerce aussi secret que lucratif: les pesticides extrêmement dangereux.
«Highly hazardous profits»: rapport d'enquête publié en avril 2019 par Public Eye.
«Highly hazardous profits»: rapport d'enquête publié en avril 2019 par Public Eye.
Public Eye a croisé les données de ventes de pesticides obtenues auprès d’une société privée d’analyse de marché avec les 310 substances figurant sur la liste du Pesticide Action Network (PAN) en raison de leurs risques élevés pour la santé et l’environnement. Cette démarche inédite a révélé qu’en 2017, votre société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,9 milliards de dollars grâce à de telles substances, plus que tout autre groupe. 15 des 32 pesticides présentés par Syngenta comme ses produits vedettes figurent sur la liste de PAN.
Nous avons également voulu savoir où vous vendez ces pesticides. La réponse: Syngenta réalise deux tiers de ses ventes de pesticides extrêmement dangereux dans des pays en développement et émergents, où la faiblesse des réglementations permet de continuer à vendre de nombreuses substances qui ne sont plus autorisées en Suisse ou dans l’Union européenne. Monsieur Fyrwald, est-ce vraiment la meilleure manière de rendre le monde meilleur pour nos petits-enfants et les générations à venir?
La vie au milieu des monocultures
En route pour l'État brésilien du Mato Grosso

Deux fois et demie la Suisse… en champs de soja
Pour comprendre la situation des personnes qui vivent à proximité des immenses champs sur lesquels ces pesticides extrêmement dangereux sont épandus, nous nous sommes rendus dans l’État brésilien du Mato Grosso. Le Brésil est le premier utilisateur mondial de pesticides. C’est aussi le principal marché de Syngenta: en 2017, ses ventes de pesticides extrêmement dangereux dans ce pays s’élevaient à 1 milliard de dollars, selon nos estimations.
Le Brésil est le deuxième exportateur mondial de matières premières agricoles après les États-Unis, et l’État du Mato Grosso est le principal producteur du pays. C’est ici que sont cultivés 27% du soja, 31% du maïs et 68% du coton brésiliens. Les terres consacrées à la culture du soja ont connu une expansion impressionnante ces dernières années: en 1998, elles occupaient 2,7 millions d’hectares dans le Mato Grosso; en 2008, 5,6 millions; et en 2018, 9,5 millions! En guise d’illustration:
Ces 9,5 millions d’hectares représentent exactement la surface dont auraient besoin les 212 millions de Brésiliens et Brésiliennes pour jouer au football en même temps, à onze contre onze, sur des terrains aux dimensions officielles de la FIFA.
Le maïs couvre près de cinq millions d’hectares, et le coton 600 000. Au cours des vingt dernières années, rien qu’au Mato Grosso, 14,5 millions d’hectares de forêt amazonienne ont été abattus – une superficie qui représente 3,5 fois celle de la Suisse.
64 litres de pesticides par personne
Les variétés de soja, de maïs et de coton cultivées ici, dont la plupart sont génétiquement modifiées, demandent une quantité massive d’insecticides, d’herbicides et de fongicides. Aucun pays au monde n’épand autant de pesticides que le Brésil. Et l’État du Mato Grosso consomme à lui seul 20% des volumes.
Selon les chiffres de l’Université fédérale du Mato Grosso (UFMT), près de 208 millions de litres de pesticides ont été épandus dans l’État en 2015. Ce chiffre représente environ 64 litres par personne. Sur les 15 substances les plus employées, 11 sont classées comme des «pesticides extrêmement dangereux» (en anglais Highly Hazardous Pesticides ou HHP) par le réseau international Pesticide Action Network.
Quelles conséquences ces substances toxiques ont-elles sur la santé de la population du Mato Grosso?
En réponse à cette question, un nom est systématiquement évoqué: celui du Dr Wanderlei Pignati, professeur à l’UMFT, à Cuiabá. Son équipe est la seule à mener, depuis des années, des recherches sur cette problématique au Mato Grosso.

Wanderlei Pignati, professeur à l’UMFT, à Cuiabá.
Wanderlei Pignati, professeur à l’UMFT, à Cuiabá.
Dans plusieurs études, Pignati et ses collègues ont mis en évidence une corrélation statistiquement significative entre l’utilisation de pesticides dans la région et les cas de cancer chez les enfants et les jeunes. Ils ont en outre constaté que les enfants dont les parents avaient été exposés à des pesticides avaient un risque nettement plus élevé de naître avec des malformations.

«Nous devons continuer, mais nous sommes comme des fourmis contre un lion»
Antonio Lemos Correa

La fille «spéciale» d’Antonio
Nous voulons mieux comprendre le quotidien de celles et ceux qui vivent au milieu de ces gigantesques exploitations constamment arrosées de substances toxiques, connaître le point de vue des médecins sur le lien entre les pesticides et certaines maladies, et parler avec des personnes qui en paient le prix fort.
À l’instar d’Antonio Lemos Correa, 34 ans, que nous rencontrons dans les bureaux de l’Associação de Espinha Bífida de Mato Grosso, à Cuiabá. Le spina-bifida est une malformation congénitale du tube neural dans la colonne vertébrale pouvant entraîner des déficiences visuelles, des paralysies et une perte de contrôle du côlon et de la vessie. Des études font état d’une corrélation entre l’exposition des parents aux pesticides et la probabilité de l’enfant de souffrir du spina-bifida. Antonio ne savait rien de tout cela… jusqu’à la naissance de sa fille, Emanuelly. La grossesse avait déjà été compliquée, nous raconte le père, puis le bébé est venu au monde avec un kyste «de la taille d’un melon» dans le dos.
Antonio nous montre fièrement des photos de sa fille sur son téléphone: Emanuelly en ballerine, avec des attelles aux jambes afin d’éviter qu’elle ne se casse les chevilles, dans lesquelles elle n’a plus aucune sensation.

«Les médecins disaient qu’elle ne marcherait jamais. Et aujourd’hui elle fait de la danse classique! Je remercie chaque jour Dieu de m'avoir donné une fille si spéciale», nous confie Antonio.
«Les médecins disaient qu’elle ne marcherait jamais. Et aujourd’hui elle fait de la danse classique! Je remercie chaque jour Dieu de m'avoir donné une fille si spéciale», nous confie Antonio.
Les médecins lui avaient demandé s’il vivait près d’exploitations agricoles. «Oui», avait-il répondu. S’il avait lui-même été exposé à des pesticides? «Oui» également.
Antonio, qui tente aujourd’hui de subvenir aux besoins de sa famille en vendant des panneaux solaires, travaillait à l’époque comme journalier dans plusieurs exploitations agricoles. Il officiait régulièrement comme «bandeira», guidant au drapeau depuis les champs les pilotes chargés de l’épandage aérien. Il portait alors un bonnet et une chemise à manches longues comme seule «protection». Le soir, il était souvent pris de maux de tête et d’étourdissements. Il ne savait pas quelles substances étaient épandues. Les entrepôts dans lesquels les produits étaient stockés étaient gardés par des hommes armés.
«Comme des fourmis contre un lion»
Selon Antonio, les cas de spina-bifida sont beaucoup plus nombreux depuis quelques années. Et la plupart des enfants traités à Cuiabá viendraient de régions d’agriculture intensive. Il connaît plus de dix cas rien que dans le village où il habitait avant. Chaque maladie est un cas particulier, concède Antonio, «mais quand il y a presque toujours un lien avec les pesticides, est-ce qu’on peut croire à une simple coïncidence?», se demande-t-il.
L’organisation au sein de laquelle il s’engage aujourd’hui lutte pour que les victimes bénéficient d’un plus grand soutien et que des mesures de protection plus efficaces soient prises, y compris l’interdiction des pesticides particulièrement dangereux. Elle demande également que les maladies soient enfin spécifiées dans les registres, plutôt que la simple mention de «malformation» sur les certificats de naissance. Cela permettrait enfin de mettre en évidence la recrudescence inhabituelle des cas de spina-bifida.
Tant que cela ne sera pas possible, les études scientifiques ne pourront que tirer des conclusions de nature générale. Une étude menée en 2016 par l’équipe du professeur Pignati dans le Mato Grosso montre, par exemple, que le risque de malformation chez l’enfant est plus de quatre fois plus élevé si ses parents ont été exposés à des pesticides, et plus élevé encore si son père travaillait dans l’agriculture. «Mais les barons de l’agro-industrie contrôlent tout ici, même la politique. Et ils n’ont aucun intérêt à ce que ce lien soit mis en lumière», estime Antonio. «Nous devons continuer à nous battre. Nos enfants ont besoin de nous. Mais nous sommes comme des fourmis qui luttent contre un lion.»
Wanderli Pignati et d’autres spécialistes brésiliens parlent des effets des pesticides sur la santé:
Vidéo: images d'Eduardo Martino (Panos Pictures), montage de Maxime Ferréol (Public Eye).

«Il y a vraiment un problème»
Elisangela Silva dos Anjos

Soupçonner que les pesticides sont la cause de la maladie de son enfant, et ne pas pouvoir le prouver : une réalité qu’Elisangela Silva dos Anjos connaît trop bien.
Nous la rencontrons à Cuiabá, dans la cour de l’Associação Amigos da Criança com Câncer, une organisation de soutien aux enfants atteints de cancer. Elisangela, 36 ans, vit avec ses trois enfants et son mari dans la petite ville de Lucas do Rio Verde, à 300 kilomètres au nord de Cuiabá. Depuis trois ans, elle parcourt régulièrement cette longue distance avec son fils cadet Kalebi, âgé de 5 ans.
Quand il avait deux ans et trois mois, Kalebi a soudain été pris d’une forte fièvre pendant la nuit. Le lendemain matin, le petit garçon était toujours très faible, ne se déplaçait plus comme d’habitude, traînait une jambe et avait le teint blême. Rien de grave, selon le personnel des urgences, peut-être un nerf qui s’était coincé. Mais quand, le soir même, Elisangela lui a pincé le bras et qu'un gros hématome s’est tout de suite formé, elle a su qu’il «y avait vraiment un problème». L’hôpital de Rio Verde a fait un prélèvement sanguin et diagnostiqué une leucémie. Kalebi a ensuite été traité par chimiothérapie à Cuiabá, jusqu'à ce que les cellules cancéreuses aient été détruites. Il doit désormais s’y rendre une fois par mois pour un contrôle, pendant huit ans.

«Personne n’ose en parler»: Elisangela, avec son fils Kalebi.
«Personne n’ose en parler»: Elisangela, avec son fils Kalebi.
Il a scientifiquement été prouvé que les pesticides peuvent accroître le risque de leucémie chez l’enfant. Une étude menée dans les hôpitaux de treize États brésiliens a notamment démontré que les enfants dont la mère avait été exposée à des pesticides pendant sa grossesse présentaient un risque plus élevé de souffrir d’une leucémie au cours de leurs deux premières années de vie. Elisangela nous raconte que la famille vivait alors près d’une plantation de coton. «Notre maison était constamment remplie de particules de coton.» Et son mari, qui était alors mécanicien sur une exploitation agricole, embrassait sa famille en rentrant du travail, alors qu’il portait encore ses vêtements professionnels desquels émanait «une odeur chimique».
Le fils de l’ancien employeur de son mari, qui exploitait une ferme, et la fille d’un de leurs voisins avaient également contracté une leucémie. Pour Elisangela, il ne fait aucun doute qu’il y a un lien entre ces maladies et l’utilisation de pesticides dans les champs autour de Lucas do Rio Verde. «Mais personne n’ose en parler.»
En route vers la «capitale de l’agronegócio»
Nous décidons de nous rendre dans la ville où Elisangela vit avec sa famille. Direction: Lucas do Rio Verde, où une collaboratrice du Dr Pignati a analysé, en 2010, le lait maternel de 62 femmes, et trouvé des résidus de différents pesticides dans chacun des échantillons. Tous contenaient notamment des traces de DDT. Cette substance très persistante, qui était autrefois produite par Ciba-Ceigy, l’ancêtre de Syngenta, est toujours détectée au Brésil, bien qu’elle n’y soit plus autorisée à des fins agricoles depuis vingt ans.
Plus nous nous éloignons de Cuiabá, plus les arbres sont petits, et plus les champs aux lignes précises, typiques des plantations de variétés transgéniques, sont immenses. En ce mois de février, les travailleurs agricoles s'affairent à la récolte des derniers plants de soja, ou sèment déjà le premier maïs «safrinha» pour la deuxième récolte. «Mato Grosso» signifie «brousse épaisse», mais au vu du paysage que nous apercevons depuis la route, on serait tenté de rebaptiser l’État «Campo Infinito».

Nous bifurquons pour emprunter la BR 163, connue comme la «route du maïs» du Mato Grosso, et commençons alors à dépasser d’innombrables camions anonymes et poussiéreux qui transportent du soja en direction du port de Santarém, à quelque 2000 kilomètres au nord. Puis nous passons à côté d’un premier silo gigantesque portant les logos des géants de l’agroalimentaire Bunge, Louis Dreyfus, Cargill et Cofco. Enfin, nous arrivons à Lucas do Rio Verde, petite ville de plus de 60 000 âmes entourée d’exploitations agricoles et qualifiée de «capitale de l’agro-industrie» dans le bulletin officiel de l’État du Mato Grosso en 2018. L’air est chargé d’une odeur pestilentielle: comme du foin fermenté, mais en plus désagréable encore. Elle provient des gigantesques silos de soja. «Ça sent souvent comme ça ici», nous dit-on.
Poulets, porcs, soja, maïs
Comment décrire Lucas do Rio Verde? Nos premières impressions: une petite municipalité comptant certainement la plus grande densité d’ateliers de montage de pneus au monde – pour les milliers de camions qui la traversent en permanence. Les deux mascottes de la ville peuvent également nous aider à en saisir les contours. La première est un porcelet de six mètres de haut, dénommé Luquinha, qui porte un épi de maïs dans une main et des fèves de soja dans l’autre. La seconde, Preciosa (la précieuse), est un poulet de dix mètres qui trône sur un giratoire à la sortie de la ville en hommage à l’industrie de la volaille.

Les mascottes de la ville, Luquinha et Preciosa.
Les mascottes de la ville, Luquinha et Preciosa.
En suivant cette route, nous passons près de l’énorme abattoir du géant brésilien de l’agroalimentaire BRF, qui emploie ici 4500 personnes pour transformer quelque 300 000 poulets par jour. La raison pour laquelle la multinationale s'est installée ici est évidente: l’abattoir est entouré de champs dans lesquels poussent le maïs et le soja nécessaires à l’engraissement des volailles. Il est fort probable que vous ayez vous-même déjà mangé un poulet provenant de ces installations: selon les statistiques de l’administration fédérale des douanes, la Suisse a importé plus de 45 000 tonnes de volailles en 2017, dont près de 18 000 du Brésil.
Le silence des médecins
Mais pour comprendre Lucas do Rio Verde, le mieux est encore d’aller à la rencontre de la population locale. Nous commençons par discuter avec Claudiomir Boff, président du syndicat des travailleurs agricoles, qui nous en dit plus sur l’utilisation de pesticides dans la région et ses conséquences sur la santé. Il nous conseille d’aller à l’hôpital pour nous faire une idée et propose de nous organiser une visite, puisqu’il est également le président de la fondation qui gère l’établissement hospitalier. Une de ses collègues est censée nous contacter, mais nous l’attendons en vain, et Claudiomir ne répond plus à nos appels.
Nous nous y rendons donc par nous-mêmes. À l’hôpital, on nous assure que la personne responsable va nous appeler, mais toujours rien. Quelques jours plus tôt, nous avions déjà cherché à discuter avec des médecins de l’hôpital universitaire de Cuiabá, en vain. Et nous connaîtrons le même échec lorsque nous nous rendrons plus tard à Sinop. Le lien potentiel entre pesticides et santé est visiblement un véritable tabou pour le corps médical de la région.







Des giratoires infestés de parasites
Notre déplacement à l’hôpital de Lucas do Rio Verde est néanmoins très instructif. Car sur le trottoir de l’Avenida Brasil, nous rencontrons un homme en habits de protection qui épand un mélange de pesticides.

L'homme est employé par la mairie pour pulvériser les giratoires et les espaces verts qui séparent les voies de circulation. Il nous explique que les produits chimiques utilisés dans les champs font fuir les insectes, qui viennent se réfugier en ville. Et l’infestation ne cesse d’empirer d’année en année.
L’insecticide de prédilection de la ville est actuellement l’Engeo Pleno, du géant suisse Syngenta. Le produit est une combinaison de thiaméthoxame – un néonicotinoïde «tueur d’abeilles» – et de lambda-cyhalothrine, un insecticide classé «perturbateur endocrinien» qui, selon les indications de Syngenta, peut entraîner une irritation aiguë des voies respiratoires, de la peau et des yeux. L’UE estime que cette substance peut même entraîner la mort en cas d’inhalation.
L’employé de la ville en est probablement conscient, mais s’il garde ses gants en caoutchouc, il n’arrive pas à retirer le film de protection en aluminium de la bouteille de pesticide. Alors il les enlève.

Sans porter de gants, l’employé de la ville appuie sur la languette avec son pouce jusqu’à ce qu’elle se déchire. Le produit éclabousse. Ses mains et ses poignets sont couverts de taches claires. La dépigmentation est causée par le «veneno», nous dit-il, le poison. Elle s’accompagne de démangeaisons.

Sa mauvaise toux viendrait aussi de la manipulation de pesticides. Bien sûr, il préférerait faire un autre métier, nous confie-t-il, mais il n’a pas fait assez d’études, et les emplois sont rares ici. Il met son masque et commence à pulvériser la pelouse. Une forte odeur de chlore se dégage, accentuée par des émanations âcres.
«Notre nature a disparu»
Darino da Silva

Le lendemain, nous quittons la ville pour aller à la rencontre des personnes qui vivent aux abords des exploitations. Dans le district de Groslândia, entouré de champs, nous nous arrêtons devant une petite maison rudimentaire.
Darino da Silva, 50 ans, profite de son jour de congé sous sa véranda. Nous l’abordons, et il s’empresse de nous servir un verre de Guarana bien frais. Darino a commencé à travailler dans les champs à l’âge de 12 ans – il y a 38 ans. Il est employé depuis 20 ans par la même exploitation, non loin d’ici. Son salaire lui suffit pour vivre convenablement, nous dit-il. Sa femme est décédée il y a dix ans d’une insuffisance rénale dont la cause n’a jamais été établie. Darino se garde de faire la moindre critique à l’encontre de son employeur, pas plus que sur les propriétaires terriens ou l’industrie agroalimentaire.
Mais il nous confie que les bananes qu’il cultive derrière sa maison sont de plus en plus petites depuis 5 ans, aujourd’hui de la taille d’un pouce. Il nous parle du citronnier qu’il a dû abattre car il avait pourri.

Les bananes que Darino cultive derrière sa maison sont de plus en plus petites.
Les bananes que Darino cultive derrière sa maison sont de plus en plus petites.
Les attaques de parasites sur ses plantes sont les pires entre novembre et février, quand le soja puis le maïs poussent dans les champs. Et puis il y a l’odeur nauséabonde dans le village: «Quand ils épandent, je ferme toutes les fenêtres», nous explique-t-il. Les voisins empêchent leurs enfants de sortir. Ces derniers souffrent souvent de maux de tête, et ils doivent régulièrement être traités au dispensaire.
Puis Darino nous parle du passé: des aras, avec leurs vives couleurs, qui venaient lui rendre visite dans son jardin il y a encore quelques années.
«Ici, là et là», nous dit-il en montrant les alentours de sa maison, «partout, il y avait de la forêt». Aujourd’hui, seuls des champs s’étendent à perte de vue, le plus proche commençant à tout juste vingt pas de sa maison.
Un engin est en train d’y épandre des pesticides. Darino nous raconte que des tapirs, des fourmiliers et des jaguars vivaient dans la région à l’époque, que les pluies étaient plus longues et plus intenses, que les températures étaient plus basses. Aujourd’hui, seules quelques rares colonies de sangliers arpentent encore les champs à la recherche de nourriture, et les exploitations s’étendent à perte de vue jusqu’aux fines rangées d’arbres encore debout sur les rives de la rivière. «Notre nature a disparu», déplore Darino.

«Avant, il y avait partout de la forêt.» Aujourd’hui, l'épandeuse passe juste devant la maison.
«Avant, il y avait partout de la forêt.» Aujourd’hui, l'épandeuse passe juste devant la maison.


Apprendre en s'amusant... avec Syngenta
Nous reprenons ensuite la route et nous arrêtons aux abords d’une école entourée de champs de soja. Une cinquantaine de mètres séparent l’établissement des exploitations agricoles. Ce n’est pas dangereux? La directrice nous reçoit très aimablement, mais dès que nous abordons la question des pesticides, son visage se crispe. «Cela ne pose aucun problème ici», nous affirme-t-elle. Bien sûr, il y a de fortes odeurs dans l’école pendant l’épandage, et elle ne peut pas affirmer que les pesticides ne causent aucun problème de santé. Mais les enfants ici se portent très bien, et il faut voir aussi tout ce que l’agriculture a apporté au village. Avant, il n’y avait pas d’éclairage public ni d’air conditionné, nous dit-elle.
Quand nous mentionnons Syngenta, elle nous demande d’attendre un instant, sort du bureau et revient très vite avec un document. Il est intitulé «Le jeu de l’environnement» et porte le logo du géant suisse. Dans ce jeu de dés, largement diffusé par l’intermédiaire d’une fondation, Syngenta explique aux enfants comment garantir la sécurité alimentaire mondiale. Le groupe y présente aussi sa définition de «la durabilité»: «Augmentation de la production sans recourir à plus de terres, utilisation responsable des ressources naturelles et promotion de la biodiversité.»
Zone interdite
Pendant que la directrice nous montre le jeu, notre collègue brésilien entend une tout autre histoire dans la cour de l’école. Une enseignante en biologie lui confie ses inquiétudes. Le nombre d’enfants souffrant d’autisme est préoccupant, et elle suspecte fortement que cela soit dû aux pesticides. Elle a déjà travaillé dans plusieurs écoles, mais n’a jamais vu autant de cas. Elle a voulu faire tester les nappes phréatiques de la région, mais a dû y renoncer en raison de l’opposition de certains pères de famille, dont bon nombre travaillent dans l’agriculture.
«Il y a des sujets que l’on n'a pa le droit d'aborder», nous dit l’enseignante en biologie. «Ici, on ne parle pas de ces choses-là». Ces phrases, nous les entendrons à maintes reprises durant notre séjour.
Notamment de la bouche d’un homme employé par les autorités, qui nous parle d’agriculteurs ayant succombé à une tumeur à l’estomac ou souffrant de gastrite des suites d’une intoxication. Mais il refuse de nous mettre en contact avec des victimes, ce serait «trop dangereux» ; ce serait pénétrer dans une «zone interdite».
Même réaction de la part d’une employée d’une institution de soutien aux malades du cancer, qui nous raconte que la plupart des patients et patientes qu’elle traite développent des tumeurs dans des zones en contact avec les aliments et l’eau: le pharynx, l'estomac, les intestins. Elle a l’intime conviction que ces cancers sont causés «par tous les pesticides utilisés ici. Mais personne ne peut le dire officiellement».
Plusieurs personnes que nous interrogeons déplorent pourtant le fait qu’une poignée de propriétaires de grandes exploitations ne cessent de s’enrichir, alors que l’État n’en retire presque aucun revenu et doit par ailleurs assumer les coûts pour soigner les malades. Plusieurs de nos interlocuteurs estiment que si l'on ne parle pas des conséquences des pesticides sur la santé, c’est parce que les hôpitaux et les médias sont aussi sous le joug des barons de l’agro-industrie et de leurs amis. Il s’agirait d’un «cercle fermé». Mais personne ne veut que son nom soit associé à ces critiques.

Un produit phare toxique
Aux abords de Lucas do Rio Verde, nous parvenons à nous faire une idée des quantités de pesticides épandues dans la région. Dans un centre de tri d’emballages vides, des milliers de bidons sont entassés, puis comprimés par deux hommes et envoyés au recyclage ou à l’incinération en fonction des matériaux qui les composent. En 2012, plus de 700 tonnes de récipients de pesticides ont été triés ici, peut-on lire dans un journal qui vantait alors les mérites de cette installation de recyclage modèle.
Un nombre impressionnant de ces bidons portent une étiquette avec le logo de Syngenta et la marque «Gramoxone». La substance active de cet herbicide est le paraquat, l’un des pesticides les plus toxiques au monde. Interdit en Suisse, le paraquat est responsable de milliers d’empoisonnements d’agriculteurs chaque année, et il est lié à plusieurs maladies chroniques, dont la maladie de Parkinson.

Le paraquat de Syngenta dans un centre de tri de Lucas do Rio Verde.
Le paraquat de Syngenta dans un centre de tri de Lucas do Rio Verde.
Quel rôle le géant suisse joue-t-il dans la région?
D’après nos recherches, Syngenta est toujours le numéro un des ventes de pesticides au Brésil. Nous savons que Syngenta y commercialise 21 substances figurant sur la liste de PAN, dont dix ne sont pas autorisés en Suisse ou dans l’UE.
Et nous savons que Syngenta vend au Mato Grosso au moins quatre substances – l’atrazine, le cyproconazole, le propiconazole et la lambda-cyhalothrine – qui sont classées «toxiques pour la reproduction» ou «perturbateurs endocriniens» et, avec le glyphosate et le diuron, au moins deux classées «probablement cancérogènes».
«Tout le monde veut acheter du Syngenta»
Nous faisons alors un tour de la ville. Nous nous arrêtons tout d’abord chez Araguaía, l’un des principaux distributeurs d’engrais et de pesticides de la région. Le vendeur, qui est sur le point de fermer sa boutique, nous confirme proposer des produits de Syngenta. Ceux qui se vendent le mieux sont les herbicides Primoleo – contenant de l’atrazine, perturbateur endocrinien avéré, néfaste pour le système reproducteur, pouvant accroître le risque de malformations congénitales et interdit en Suisse depuis 2007 – et ZappQi (contenant du glyphosate), ainsi que le fongicide Elatus et l’insecticide Engeo Pleno, que nous connaissons déjà.
Le lendemain matin, nous passons au magasin Agrológica, l’un des deux partenaires officiels de Syngenta dans la région. Derrière des piles de brochures publicitaires de pesticides, d’engrais et de tracteurs, un vendeur enthousiaste nous raconte que les produits de Syngenta sont dans leur catalogue depuis 2016. Il affirme que ce partenariat est une grande source de fierté pour le magasin, car Syngenta est un grand nom: la société est synonyme de produits certes chers, mais de grande qualité. «Tout le monde ici veut acheter des produits de Syngenta», nous dit-il. Quand nous lui demandons quels produits se vendent le mieux, il répond sans hésiter «l’herbicide ZappQi». Pendant chaque saison de culture du soja, 100 000 à 120 000 litres sont vendus dans cette filiale.
Le vendeur fait la liste des pesticides de Syngenta qui se vendent le mieux dans la région. Il mentionne six substances extrêmement dangereuses qui ont été associées au cancer et à des malformations.


«Allons plus loin, ça sent le poison ici»
Antonio Carlos da Silva

Au-dessus des nuages
Nous voulons encore en savoir plus sur les conséquences de l’utilisation excessive de pesticides sur la santé, et reprenons la route en direction de Sinop, autre pôle de l’agro-industrie situé à près de 150 kilomètres au nord de Lucas do Rio Verde. En chemin, nous nous arrêtons près d’un hangar.
Nous y rencontrons Antonio Carlos da Silva – qui précise immédiatement n’avoir aucun lien de parenté avec l’ancien président Lula, de son vrai nom Luiz Inácio da Silva, actuellement en détention. L'homme a tout du pilote agricole brésilien typique: chemise à carreaux, chaîne en or, jeans troués, forte odeur de bois de santal, le visage aux traits tirés comme s’il avait été modelé par les années de vol. Plus tard, il nous fera une démonstration d’acrobatie en passant sous les lignes électriques qui bordent son champ, comme il aime le faire quand il a de la visite.

Les affaires vont bien, nous raconte Antonio: «On pulvérise aujourd’hui plus de pesticides qu’avant.»
Les affaires vont bien, nous raconte Antonio: «On pulvérise aujourd’hui plus de pesticides qu’avant.»
Mais avant cela, devant son avion à hélices baptisé «Ipanema», il nous fait un petit discours sur les bienfaits de l’épandage aérien. Il nous montre comment l’avion est nettoyé après chaque application et comment l’eau est traitée. «Personne ne fait cela avec un tracteur», se félicite-t-il. Non seulement il parvient à couvrir 60 hectares en 20 minutes, mais il n’écrase pas le moindre plant, alors qu’un tracteur détruit en moyenne trois sacs de soja par hectare traité.
Toujours plus de pesticides
Pendant que nous écoutons Antonio, une odeur âcre nous pique le nez: elle provient de la grande cuve dans laquelle son employé mélange des pesticides. «Allons plus loin, ça sent le poison ici», nous dit-il. Si même cet homme utilise le terme «veneno» (poison), alors il paraît évident que, au moins sur le plan sémantique, l’industrie agricole et les politiques qui la soutiennent défendent des causes perdues.
La révision de la législation dont discute actuellement le Parlement, surnommée «paquet toxique» par ses détracteurs, vise non seulement à simplifier la procédure d’enregistrement de pesticides controversés, mais aussi à éliminer le terme «agrotóxicos», lui préférant l’appellation «defensivos agrícolas». Mais toutes les personnes avec lesquelles nous avons discuté parlent d’«agrotóxicos», voire, le plus souvent, de «venenos».
Antonio travaille principalement sur le champ de sa tante, mais il est parfois contacté par des entreprises comme Syngenta pour traiter les champs sur lesquels elles testent de nouvelles variétés. Il ne sait pas ce qu’il épand sur ces terres, nous confie-t-il, les produits lui étant toujours remis dans des récipients non étiquetés. Les affaires vont bien pour Antonio: «On pulvérise aujourd’hui plus de pesticides qu’avant.»
Il y a 15 ans, par exemple, on ne devait utiliser un fongicide qu’en cas d'infestation, mais aujourd'hui, on en applique en moyenne trois fois par saison sur le soja et le maïs, et jusqu’à dix fois sur le coton. Et la quantité d’insecticides nécessaire ne cesse d’augmenter car les nuisibles développent des résistances, par exemple à l'Engeo Pleno de Syngenta, dont nous apercevons plusieurs bidons ici. «Cette année, il ne fonctionne plus aussi bien qu’avant», nous dit Antonio. Il nous explique que le produit a rendu de bons et loyaux services pendant plusieurs années, mais que de nombreux insectes y sont devenus résistants, du moins sur les champs qu’il traite.

Ney, le «mélangeur de poison».
Ney, le «mélangeur de poison».
Puis Antonio monte dans son avion et prend son envol. Nous profitons de ce moment pour discuter avec Ney, son «doseador», chargé de mélanger les produits. Il travaille depuis cinq ans sur cette exploitation, où il vit également avec sa femme, et effectue les tâches qu’on lui confie. D’octobre à mars, sa principale mission est de «misturar veneno», mélanger le poison, nous dit-il. Il porte des gants et des bottes, mais pas de masque, malgré la forte odeur âcre qui se dégage des bidons. Après avoir préparé le mélange, il lui est déjà arrivé de tousser et d’avoir de la peine à respirer, mais rien de grave, selon lui, ça fait partie du métier, «mais on le sent, c’est sûr».



Beaucoup d’argent, peu de goût
Nous reprenons la route vers le nord, et passons près de la petite ville de Sorriso, qui se targue elle aussi d’être la «capitale de l’agro-industrie», et du quartier de Costa Brava, où certaines des plus grandes fortunes de la région ont installé leurs luxueuses propriétés derrière de hauts murs surmontés de fils barbelés.
Nous arrivons enfin à Sinop, où nous sommes accueillis par un panneau arborant le slogan «Ici, les affaires sont bonnes». Pour Syngenta, cela semble être une réalité, puisque nous apercevons le logo du groupe sur de nombreux bâtiments. Un distributeur s’est même donné la peine d’inscrire soigneusement sur sa devanture les noms des 20 produits de Syngenta qu’il propose dans son catalogue. Pas moins de 15 d’entre eux contiennent des substances classées «extrêmement dangereuses» par le réseau Pesticide Action Network.

Perdue au milieu de la forêt amazonienne il y a seulement 45 ans, la ville de Sinop compte aujourd’hui 150 000 âmes. Une monotonie brute et froide se dégage de cette ville entourée de champs. Les églises, restaurants, centre commerciaux, et même les bâtiments des entreprises agricoles sont tous identiques: carrés, massifs, anonymes.
Les rues semblent être le terrain d’une compétition de pick-up, dont certains arborent fièrement le portrait de campagne du président, Jair Bolsonaro: «Brutal, rustique et systématique». Son slogan pourrait tout à fait s’appliquer à la ville.
«Davantage de cancers, de malformations et de dépressions»
João de Deus da Silva Filho

«Parlez-en à João»
Sinop n’est décidément pas une ville des plus hospitalières. Mais avant de la quitter, il y a un homme que nous devons rencontrer. Il nous a été recommandé par un professeur de mathématiques membre d’une coopérative qui produit des aliments bio sur l’une des rares parcelles où cela est encore possible dans la région. «Parlez-en à João», nous a-t-il conseillé.
De son nom complet João de Deus da Silva Filho, ce biologiste et expert en santé publique est employé par le ministère de la Santé. Il nous reçoit dans son bureau sans fenêtre, prend son carnet de notes et nous décrit la situation sanitaire actuelle: les maladies respiratoires ont augmenté, tout comme le nombre de cancers de l’estomac, de la peau et du côlon, les malformations, les avortements spontanés, les affections rénales et les dépressions. «Nous constatons que le nombre de cas augmente avec l’intensification de l’emploi de pesticides», nous explique-t-il. S’il est très difficile de lancer un débat sur la question dans cette région dominée par l'agro-industrie, João refuse de se taire, «même si l’on risque de se faire tirer dessus en abordant ce problème».
Deux choses sont essentielles à ses yeux pour que la situation évolue. Premièrement: il faut plus d’études scientifiques. «Jusqu’à présent, il n’y a que les travaux du Dr Pignati.» Car il est presque impossible d’obtenir des fonds pour faire des recherches sur les effets des pesticides. Selon João, l’État devrait financer ce type d’études, et les dangers de ces produits devraient être enseignés dans les écoles pour permettre une prise de conscience et un débat. Et deuxièmement, les consommateurs et consommatrices devraient se réveiller. «Si celles et ceux qui achètent notre soja et notre maïs demandaient des aliments sains, alors la situation pourrait évoluer. Mais tant que cela leur est égal, rien ne changera.»
«Plus qu’un vaste désert»
Le biologiste veut nous montrer quelque chose. Il monte dans sa voiture et nous invite à le suivre. Nous quittons Sinop à travers les champs de coton et nous arrêtons au bord de la rivière Teles Pires. João nous explique que cette zone était autrefois un territoire autochtone. Aujourd’hui, on ne voit que des champs, et les pesticides qui y sont épandus finissent dans la rivière. Si des mesures ne sont pas prises rapidement, «les terres des autochtones vont continuer à se réduire, les champs à s’étendre, l’utilisation de pesticides à s’intensifier et le taux de mortalité à augmenter». João semble peu optimiste: «Car nous avons maintenant un fou à la tête du gouvernement.»

Depuis qu’il est au pouvoir, le premier acte officiel de Jair Bolsonaro a été de transférer au ministère de l’Agriculture la responsabilité des agences chargées de l’attribution des terres aux peuples autochtones et aux agriculteurs. Puis il a désigné comme ministre de l’Agriculture Tereza Cristina, dont l’inébranlable engagement en faveur de l’allègement des exigences d’enregistrement des pesticides lui a valu le surnom de «Musa do Veneno», ou muse du poison. Sous sa direction, le ministère a déjà autorisé 121 nouveaux pesticides depuis le début de l’année.
Les terres consacrées à la culture intensive de coton s’étendent rapidement. Et le gouvernement brésilien, dans sa volonté de croissance des investissements, estime que le volume de soja produit au Brésil passera de 114 millions de tonnes aujourd’hui à 288 millions en 2027. Un changement de paradigme vers une agriculture plus durable, ou une utilisation plus modérée des pesticides, semble donc illusoire. «Si nous continuons ainsi, nous dit João de Deus da Silva Filho, en regardant les champs qui s’étendent à perte de vue, la région, dans 50 ans, ne sera plus qu’un vaste désert.»


Nos revendications
Afin de protéger les générations futures, il est essentiel de retirer du marché les pesticides extrêmement dangereux et de les remplacer par des alternatives plus sûres.
Dans une pétition, Public Eye demande à Syngenta de mettre un terme à la production et à la vente de pesticides extrêmement dangereux.
La responsabilité de la Suisse
En tant qu’hôte du numéro un mondial des pesticides, et pays producteur, la Suisse a aussi une responsabilité particulière:
- Elle doit interdire l’exportation de pesticides bannis en Suisse en raison de leurs effets sur la santé humaine ou l’environnement, comme le demande une motion de la Conseillère nationale Lisa Mazzone (Verts/GE).
- Face au refus des firmes comme Syngenta d’agir sur une base volontaire, les autorités doivent inscrire dans la loi un devoir de diligence en matière de droits humains et d’environnement, tel que le propose l’initiative pour des multinationales responsables, et s’engager en faveur d’un traité international sur les pesticides extrêmement dangereux.

Avec le soutien de la Fédération genevoise de coopération et la Fédération vaudoise de coopération.

Agir ici pour un monde plus juste
Regarder là où les sociétés voudraient que leurs activités restent dans l’ombre, dénoncer les méfaits et proposer des mesures concrètes pour y remédier: c’est la mission que se donne Public Eye.
Des reportages tels que celui-ci ne peuvent être réalisés que grâce au soutien de nos membres et donateurs: devenez membre de Public Eye et aidez-nous à mettre les sociétés comme Syngenta face à leurs responsabilités!
Pour mieux connaître notre travail, vous pouvez commander gratuitement les trois prochains numéros de notre magazine ou vous abonner à notre newsletter.
Texte: Timo Kollbrunner, Public Eye
Traduction et édition: Maxime Ferréol et Géraldine Viret
, Public Eye
Photos: Lunaé Parracho/Reuters
Conception web: Floriane Fischer, Public Eye
Collaboration: Laurent Gaberell et Carla Hoinkes, Public Eye - Luana Rocha, Repórter Brazil
Avec le soutien de la Fédération genevoise de coopération et la Fédération vaudoise de coopération.